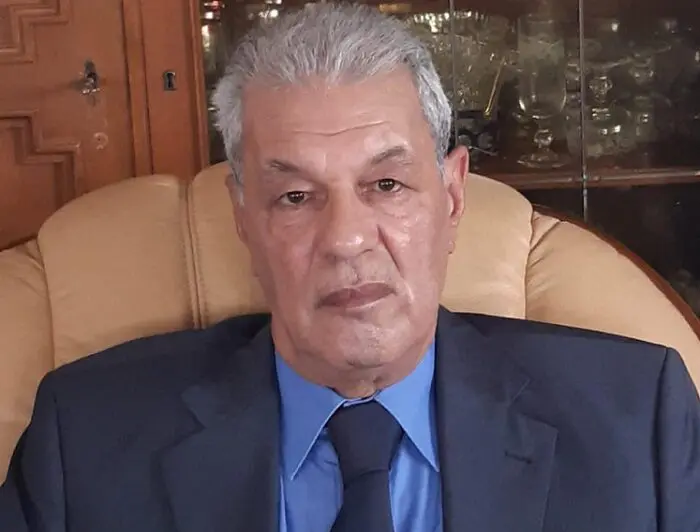L’Algérie s’exclut d’elle-même du processus de règlement de la question du Sahara -et le Conseil de sécurité devrait logiquement entériner une décision dans ce sens- parce qu’elle prend parti dans ce conflit, en reconnaissant la RASD, donc anticipe l’issue du processus, et sa participation à recherche d’un règlement sera de ce fait, partiale.
La France, par contre, est membre permanent du Conseil de sécurité, disposant du droit de véto, et compte parmi les cinq membres, en charge de la paix et de la sécurité dans le monde. À ce titre, et comme les États-Unis, elle considère que le plan d’autonomie marocain, présenté en 2007, est la seule option pour le règlement de ce conflit, sous souveraineté marocaine.
L’Algérie perd toute crédibilité, pour pouvoir éventuellement jouer le rôle de médiation ou d’arbitrage dans ce conflit, dès lors qu’elle reconnaît la RASD.
Pire, l’Algérie gère ce dossier comme étant une question nationale de politique intérieure, relevant de la souveraineté nationale, en condamnant tout pays qui proclame son adhésion à la position marocaine, comme ce fut le cas de l’Espagne, et aujourd’hui, de la France.
L’Algérie rappelle son ambassadeur en France, comme si la décision française constituait une ingérence dans les affaires intérieures de l’Algérie. Le comportement de l’Algérie sur le plan diplomatique, dans ce conflit, est étrange, étonnante et surprenante, dérogeant gravement aux pratiques et aux usages en droit international. Au lieu et place de la RASD, qu’elle a «le privilège exceptionnel» et «l’honneur» de reconnaitre, et d’abriter sur son territoire, c’est bien l’Algérie qui déploie tout son potentiel diplomatique (condamne, rappelle son ambassadeur, menace de suspendre les livraisons de gaz et les transactions commerciales) contre ses partenaires, qui osent défier «la force de frappe», en soutenant la thèse marocaine.
Je considère personnellement que le Conseil de sécurité a commis dès le départ, c’est-à-dire, au début du processus de paix, l’erreur d’inscrire l’Algérie parmi les pays concernés par le conflit du Sahara. Certes, l’Algérie est un pays voisin, et là, s’arrêtent son statut et son rôle, comme d’ailleurs la Mauritanie, qui n’a pas interféré sur les décisions souveraines de Madrid et de Paris.
Le Conseil de sécurité aurait dû, tout au plus, recueillir son avis, comme il le fait avec la Mauritanie. Il y aurait lieu à mon avis de rectifier le traitement réservé par le Conseil à l’Algérie qui, en reconnaissant la RASD, s’exclut automatiquement de ce processus. C’est sur la base de cette erreur de départ que l’Algérie bloque depuis plusieurs années les négociations qui devaient concerner les deux principaux protagonistes, le Maroc et le Polisario. Le Conseil de sécurité aurait dû également imposer le recensement des populations dites sahraouies séquestrées sur le territoire algérien, ou dans le cas contraire, et à défaut de la collaboration algérienne, suspendre toute aide à ces populations, y compris la consultation d’Alger, sur ce dossier.
Il est franchement malhonnête et inconcevable que les organismes des Nations unies continuent, pendant 50 ans, de financer l’aide à ces populations, sans leur recensement et leur identification. Il est également inacceptable que les Nations unies continuent, pendant 50 ans, de traiter ce dossier comme un dossier «transitoire» et «en suspens», sans pouvoir définir le statut de ces populations en droit international. Il s’agissait de savoir en l’occurrence si ces populations étaient des réfugiées et dans ce cas, il fallait appliquer le droit international, qui accorde la liberté de mouvement à ces populations, et la possibilité individuelle pour chacun de rentrer au Maroc ou d’aller là où il le souhaite, avec un passeport de réfugié, et bien évidemment, lever le siège implacable et cruel imposé à ces populations depuis 50 ans.
En plus de ces défaillances et ces failles dans le traitement de ce dossier, plus grave, le Conseil de sécurité accorde à ce pays, qui reconnait la RASD et qui s’exclut automatiquement de tout objectif d’arbitrage et de médiation, le droit de valider ou de rejeter des initiatives de l’ONU pour le règlement de ce dossier.
Il faut espérer que la France puisse, dans une nouvelle stratégie pour faire avancer le processus de paix, remettre à sa place l’Algérie, pour la réinjecter dans la position, qui est celle de la Mauritanie. Cette nouvelle stratégie, qui tendrait à relancer sur des bases nouvelles le processus, devrait aussi redéfinir les nouvelles tâches de la mission de maintien de la paix au Sahara, en renvoyant aux calendes grecques certaines notions désuètes et caduques, comme le référendum, pour consacrer les nouvelles tendances qui se manifestent à travers les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007.
Dans le cas de la question palestinienne, l’Algérie n’est jamais allée jusqu’à rompre ses relations diplomatiques avec les pays qui soutiennent Israël, bien qu’il s’agisse dans ce cas, d’un problème historique et juridique pendant au niveau international.
*journaliste et écrivain