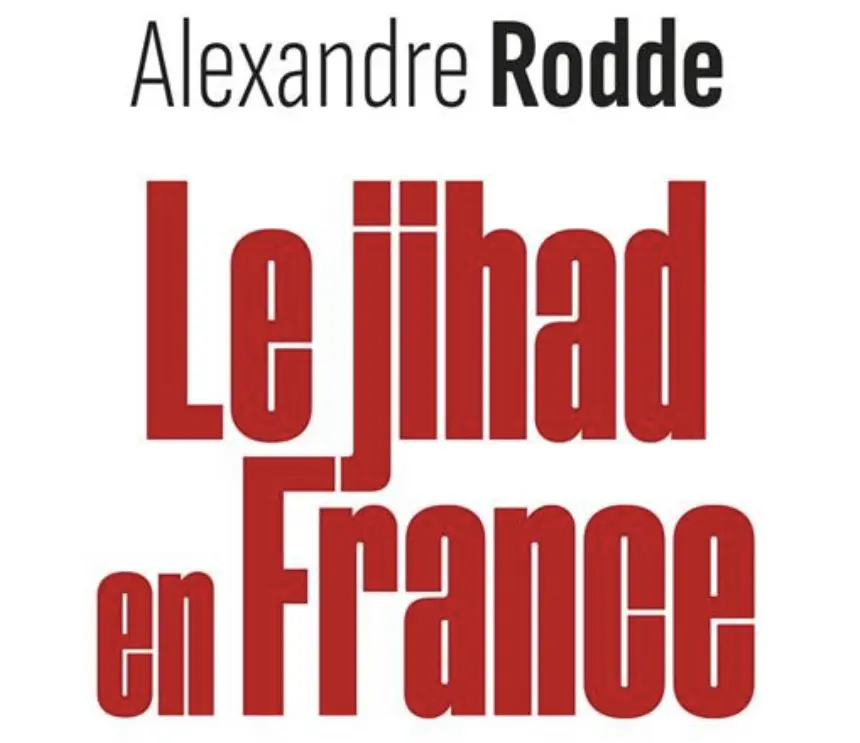«Le Jihad en France – 2012-2022», un livre d’Alexandre Rodde paru avant quelques jours aux éditions du Cerf, démontre comment le refus officiel algérien d’admettre l’existence d’AQMI a nourri le terrorisme islamiste alors que le discours sécuritaire européen lui attribue une dimension tentaculaire d’une énorme nuisibilité.
On sait que le pouvoir en Algérie a mis en pratique une logique identique à celle des terroristes, à savoir l’utilisation de la terreur et de la répression pour mater tout danger. On sait aussi que le régime algérien a longtemps persisté à ne pas reconnaître l’existence d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) alors que les terroristes se livrent à des actions d’une ampleur inédite qui dépasse celle, par exemple, menées par les groupes islamiques armés (GIA), l’Armée islamique du salut (AIS), ou encore le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).
Dans son livre «Le Jihad en France – 2012-2022», paru avant quelques jours aux éditions du Cerf, l’écrivain Alexandre Rodde démontre comment l’Algérie a été le base-arrière de tous les attentats ayant secoué la France. «La première vague djihadiste sur le sol national a pour origine la situation politique et sécuritaire en Algérie. En décembre 1991, le Front islamique du salut (FIS), un parti politique islamiste qui inquiète le gouvernement algérien, arrive en tête aux élections législatives avec près de 48 % des voix. Cette victoire électorale crée de nombreuses divisions au sein du pouvoir. Deux semaines plus tard, un coup d’État a lieu, sous la coupe de généraux et d’officiers militaires qui décident d’annuler l’élection et de confier le pouvoir à un Haut comité de sécurité (HCS). Plusieurs dizaines de milliers de militants du FIS sont arrêtés, incarcérés ou envoyés dans des camps de travail dans le Sahara. C’est le début de la Décennie noire, la guerre civile algérienne qui durera plus de 10 ans et coûtera la vie à 150 000 personnes. La France, ainsi que la toute récente Union européenne, soutiennent le gouvernement algérien. Une succession d’actions de guérilla et d’attaques terroristes débute alors. On observe l’apparition de nombreux groupes djihadistes, certains menés par des anciens de la filière afghane. Parmi eux, le Groupe islamique armé va étendre ses attaques aux intérêts de la France. En mai 1994, deux religieux français sont abattus à Alger. En août, c’est l’attentat d’Ain Allah, dans la commune de Dely Ibrahim. Au cours de la prise d’otage qui s’ensuit, trois gendarmes mobiles de l’escadron de Valenciennes sont assassinés ainsi que deux agents consulaires. Un troisième gendarme mobile est gravement blessé. La prochaine attaque atteindra le sol national», détaille M. Rodde.
Permissivité sécuritaire algérienne
Un autre récit est encore plus sanglant. «Le 24 décembre 1994, les bipeurs du GIGN résonnent dans Satory. Le vol Air France 8969 vient d’être la cible d’une prise d’otages à l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger. Les quatre terroristes se sont fait passer pour des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure et menacent désormais plus de 200 passagers. Le GIGN est inquiet de l’action des policiers algériens qui circulent autour de l’appareil, au risque d’envenimer la situation. La question d’une intervention sur place se pose (…) La situation se complexifie lorsque les terroristes commencent à abattre des otages : d’abord un diplomate vietnamien, puis un policier algérien présent dans l’aéronef. C’est ensuite au tour de Yannick Beugnet, âgé de 28 ans et cuisinier à l’ambassade de France, d’être assassiné d’une balle dans la tête avant d’être jeté hors de l’avion. Les autorités françaises font désormais pression sur le gouvernement algérien : soit l’avion décolle en direction de la France, soit le GIGN intervient en Algérie. L’avion décolle, mais ses réserves de carburant ne peuvent pas permettre d’atteindre Paris. C’est donc l’aéroport de Marignane qui sera choisi comme escale.»
Affaire Merah, ou quand les officiels algériens laissent un individu dangereux libre
«Mohamed Merah est déjà fiché S depuis 2006, mais l’administration pénitentiaire n’en a pas été informée, et ne peut donc surveiller sa radicalisation. Mais Merah continue ses échanges avec son frère et les autres membres de la filière d’Artigat, tenant des propos de plus en plus extrêmes. Il sait désormais ce qu’il compte faire en sortant de prison. Il est prêt, et a même fait renouveler son passeport depuis son lieu de détention. Libéré à l’automne 2009, Mohamed Merah reprend ses activités de délinquant. On le soupçonne de cambriolages, de vols avec violences, de participer à des go fast pour des trafiquants de stupéfiants. Il a des projets de djihad et besoin de financement. Ses liens avec la mouvance salafiste se renforcent, mais il cherche à faire plus que les salafistes qu’il fréquente. Pourtant, le 30 mars 2010, sa fiche S n’est pas renouvelée. Il prend la direction de l’Algérie le 15 avril 2010, pour un séjour de deux mois. Il loue un appartement à Boumerdès, ville côtière située entre Alger et Tizi Ouzou. La région est connue pour la forte implantation de la menace djihadiste. Deux ans auparavant, en août 2008, un terroriste avait placé un véhicule explosif devant l’École supérieure de gendarmerie des Issers, tuant quarante-huit personnes, principalement des étudiants qui passaient le concours d’admission», note l’écrivain.
«Pendant son séjour en Algérie, il est contrôlé par des militaires mais est relâché. Il décide de rentrer en France. En juillet, il se présente au poste de recrutement de la Légion étrangère à la caserne Pérignon de Toulouse. Son objectif naïf est de passer les tests de sélection, rejoindre un régiment déployé en Afghanistan et durant une mission de combat», a-t-il dévoilé.
Le livre de M. Rodde «autorise à raisonner au plus près des événements, en se fondant d’abord et avant tout sur les faits» et prouve qu’en Algérie, l’islamisme, comme le terrorisme qui l’a suivi, ainsi que la multiplication des conflits et la montée de la violence, n’ont pas seulement engendré la misère sociale, la crise identitaire ou la résurgence religieuse, mais aussi des attentats qui ont semé la terreur en France et en Europe.