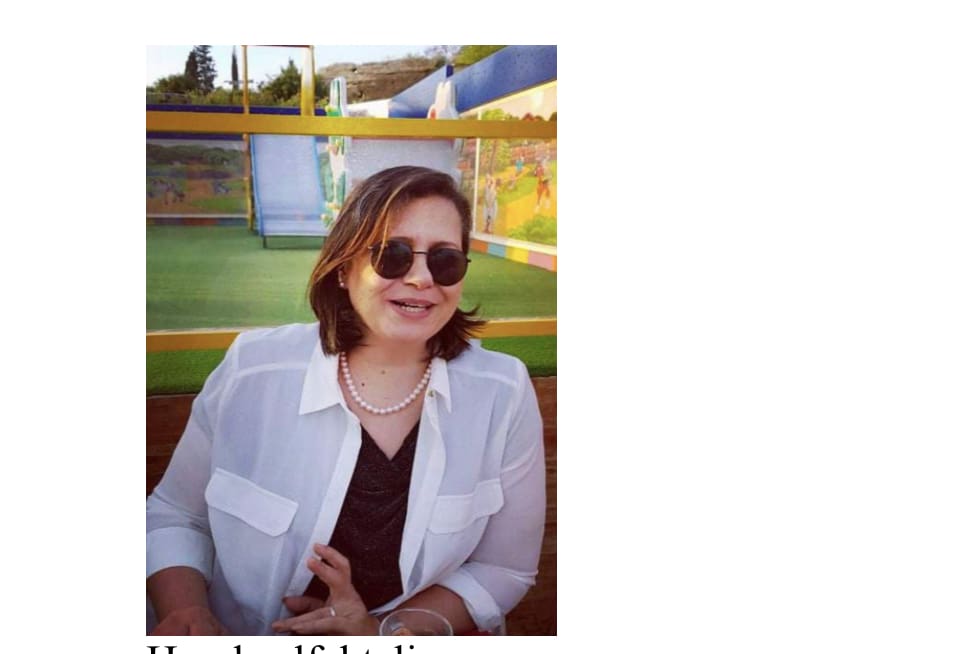Indubitablement, notre jeune génération ne sait plus à quel saint se vouer. Elle est constamment confrontée à cette barrière religieuse (hallal /haram) qui la divise, notamment dans des thèmes liés à certaines expressions artistiques, tels le cinéma, le théâtre, la musique, la sculpture et même la poésie..
Ces thèmes qui ne cessent d’entraîner questionnement et doutes au sein de la société, reviennent quotidiennement sur le devant de la scène médiatique, amplifiés par la propagation d’un discours religieux radical à propos de l’illicéité des arts, tenu par des mouvements islamistes qui ont enregistré une forte percée durant ces deux dernières décennies. C’est dire que la religiosité au sein de la société, ne se manifeste pas seulement dans les domaines qui lui sont systématiquement couplés, tels le jeûne, la prière, la zakat et autres.., mais aussi dans d’autres champs de la vie quotidienne, à l’image de la musique considérée par certains comme une pratique à moitié tolérable (mi-halal, mi-haram) lorsqu’il s’agit de la musique religieuse madih et samâ et entièrement haram pour tout autre genre musical (chaâbi, musique andalouse, gharnati, al mallhoun, musique moderne, orientale, classique..).
Les raisons derrière ce rejet par une certaine catégorie de jeunes où l’effet des thèses islamistes semble beaucoup plus affirmée, sont diverses, mais bon nombre d’entre eux justifient leur démarche par des considérations religieuses. La mère apparaît comme l’un des facteurs d’influence, mais le père s’impose comme l’encadreur principal de l’orientation religieuse. ‘’Écouter de la musique me déconcentre, m’éloigne de la voie juste’’, se désole Amina (38 ans), une tatoueuse du henné dans le quartier Bab Jdid de Meknès, soutenue par sa consœur Hajar, presque du même âge, qui, fortement fixée sur les enseignements radicaux de son père, considère la musique comme une pratique impure. Une situation qui rappelle le cas de Slimane, un imam de 36 ans qui prêche dans un quartier huppé de Meknès, (ville nouvelle), et qui a créé une grosse polémique avec son discours sur l’illicéité de la musique, de la danse et même de la poésie.
Il a été congédié pour ses propos qualifiés d’asservissement sociétal venu de l’islam radical. Pour lui, toutes les expressions artistiques sont illicites, excepté la poésie qui prodigue des louanges à l’endroit de l’islam et au prophète Sidna Mohammed. De tels propos suscitent ironie et amertume chez Mouhtadi, un jeune enseignant universitaire du même quartier, pour qui l’islam bien compris “est une religion d’ouverture sur la culture de l’autre dans ses différentes expressions artistiques”, précise-t-il à Barlamane.com, avant de s’insurger contre le fait que la musique pose problème uniquement pour un courant radical de l’islam, qui n’est représentatif que d’une infime minorité des Marocains. Pour ce Meknassi soucieux d’authenticité, la richesse de la culture arabe se reflète dans plusieurs siècles de tradition poétique et musicale.
Depuis les ères qui ont précédé la naissance de l’islam, la musique et la poésie égayaient, explique-t-il, le mode de vie des arabes où musiciens, chanteuses, danseuses, poètes et maîtres du oud, animaient soirées, fêtes et salons littéraires de l’aristocratie arabe. Une réalité que partage sa voisine Hakima, directrice d’un centre des langues, non loin de la quarantaine, qui, animée d’une flamme soufie tournée vers la foi intérieure, vit la musique et la poésie non seulement comme un mode de vie et de pensée, mais encore plus, comme un moyen de s’élever vers dieu. Elle sous-entend par cette allusion que l’art poétique et musical en tant que forme de connexion émotionnelle reliant chanteur, poète et auditeur, ne peut être louable dans un genre artistique et blâmable dans un autre.
Se référant à l’œuvre du grand maître de la spiritualité islamique, Ibn Arabi, elle conçoit la poésie et la musique comme un moyen de purification de soi, une vertu spirituelle qui se forge, à l’évidence, dans l’amour de l’art et qui donne accès à l’autre côté du miroir, à cet ailleurs où poésie, voix et instruments convergent pour le grand plaisir des mélomanes. Dire enfin que l’attachement à la religion dans ces concepts “halal-haram”, quoiqu’il semble gagner du terrain, les Marocains dans leur quasi-totalité conçoivent la musique et la poésie, comme moyen d’enrichissement de l’âme et de l’esprit, efficace contre le stress et l’anxiété, à prescrire sans modération.